|

| |
|
Édito
Bonjour à toutes et tous,
Peut-être vous étonniez-vous de ne plus recevoir de Lettre de l'AFEF depuis quelques mois... Rassurez-vous, ce n'était pas une erreur, mais les mois de juin ont été extrêmement occupés par la préparation du XVIe Congrès mondial de la FIPF que l'AFEF organisait à Besançon du 10 au 17 juillet. Vous en trouverez quelques échos ci-dessous.
C'est la rentrée, et je ne vais rien ajouter aux encouragements habituels pour qu'elle se passe au mieux pour vous, ni aux craintes qui vous habitent face à un présent et un avenir assombris dans l'éducation. Bon courage, et faites au mieux dans vos classes, comme toujours !
L'AFEF fait une rentrée particulière, une année stimulante s'annonce pour nous toutes et tous. L'organisation de l'association va se restructurer, nous allons prendre le temps de trouver un autre fonctionnement, et nous faisons appel à vous pour nous rejoindre : nous avons besoin de vous !!!
Et, comme nous avons besoin d'être le plus nombreux possible pour cette nouvelle vie de l'AFEF qui démarrer, pensez, si ce n'est déjà fait, à adhérer. Notre nombre d'adhérent·es, en baisse constante, nous fait peur pour construire un avenir radieux !
À très bientôt, bonne rentrée,
Viviane Youx
|
|
|
| |
Quelques infos que vous auriez pu rater...
Denis Paget : Les points aveugles du projet de nouveau socle commun de 2025 - Éditorial du CICUR, septembre 2025
Chacun cherche son IA : Alix Callies présente son programme d'écriture Ecrivor dans le dossier "Un défi pour l'école" de Télérama (27/08/2025)
Bernard Lahire [Savoir ou périr, Seuil, 2025] : « L’obsession évaluative a détourné l’école de sa fonction de transmission des connaissances », lire dans le Café pédagogique (1/09/2025)
Jean-Paul Delahaye [Frapper les pauvres, éditions de la librairie du Labyrinthe, 2025] : « Une société et un système éducatif qui demeurent profondément injustes », lire dans le Café pédagogique (25/08/2025)
***
Retour sur le Congrès
L'équipe de l'AFEF s'est mobilisée pour organiser le XVIe Congrès mondial de la FIPF DU 10 au 17 juillet : Besançon2025. Les théâtres, l'université, les rues de Besançon ont résonné des "Utopies francophones en tous genres" qui ont nourri les réflexions sur la francophonie, les langages, les littératures, l'écriture, l'enseignement de l'orthographe. Réflexions accompagnées de multiples échanges, sourires, rires qui auront marqué ce congrès !
Retrouvez la séance d'ouverture en vidéo avec la remarquable conférence inaugurale de Jean-Louis Chiss : "Les utopies linguistiques et culturelles, langue et culture" [à 2h25].
Et la passionnante conférence de clôture de Philippe Meirieu : "Utopies éducatives" grâce à son diaporama.
L'AFEF a aussi organisé deux tables rondes :
- sur l'écriture créative collaborative : "Le défi de l’écriture créative et collaborative en classe"
- sur l'enseignement de l'orthographe : "Faire évoluer l'orthographe et son enseignement, une utopie ?" Lisez l'Appel du 14 juillet 2025 "Pourquoi il est urgent de mettre à jour notre orthographe ?"
(voir le programme complet pour les intervenant·es)
Et a assuré une présence quotidienne d'écrivains, de la francophonie, Français, Bisontins pour faire vivre une littérature présente.
Retrouvez quelques images du congrès en diaporama
Et aussi...



 
 |
| |
|
| |
18-21 octobre : Journées nationales de l'APMEP : "Les mathématiques ont toujours la côte", Toulon
15 novembre : Colloque sur la spécialité « Humanités, Littérature et Philosophie organisé par l'APPEP, ENS, 45 Rue d'Ulm, Paris
|
| |
|
| |
|
| |
Programme national d'œuvres pour l'enseignement de français pour l’année scolaire 2026-2027
Le programme de français fixe quatre objets d'étude pour la classe de première : la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle, la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle, le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle, le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Chacun des objets d'étude associe une œuvre (ou une section substantielle et cohérente d'une œuvre) et un parcours permettant de la situer dans son contexte historique et générique. Le programme national de douze œuvres, renouvelé par quart tous les ans, définit trois œuvres par objet d'étude, parmi lesquelles le professeur en choisit une et son parcours associé.
La liste des œuvres et des parcours inscrits au programme de première pour l'année scolaire 2026‑2027 et pour les épreuves anticipées de la session 2028 du baccalauréat est la suivante :
Classe de première de la voie générale
Objet d'étude pour lequel les œuvres sont renouvelées
- Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la charrette (édition bilingue) / parcours : le roman et l'invention de l'amour.
Zola, Pot-Bouille / parcours : dévoiler les rouages de la société.
Simone Schwarz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle / parcours : tisser les mémoires, habiter le monde.
Objets d'étude pour lesquels les œuvres sont maintenues (lire sur le B.O.)
Classe de première de la voie technologique
Objet d'étude pour lequel les œuvres sont renouvelées
- Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la charrette (édition bilingue) / parcours : héroïsme et amour.
Zola, Thérèse Raquin / parcours : anatomie des passions.
Simone Schwarz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle / parcours : tisser les mémoires, habiter le monde.
Objets d'étude pour lesquels les œuvres sont maintenues (lire sur le B.O.)
|
| |
Bulletin officiel n° 30 du 24 juillet 2025 |
| |
|
| |
|
|
|

Palmarès du 10e Concours mondial d'écriture collaborative
Florilège-FIPF : "Utopies"
organisé dans le cadre du XVIe Congrès mondial de la FIPF
Besançon2025
Lire le palmarès en cliquant
Un grand merci aux classes participantes, et à leurs professeur·es !
La prochaine édition du concours d'écriture créative collaborative sera annoncée prochainement
|
| |
| |
| |
À lire, à voir, à entendre
|
|
| |
|
| |
En dehors des sentiers battus de la rentrée littéraire,
Histoires de sorcières
puisque nous le sommes toutes et tous, ou personne...
En écho à la belle exposition du musée de Pont-Aven :
Sorcières (1860-1920) : fantasmes, savoirs, liberté
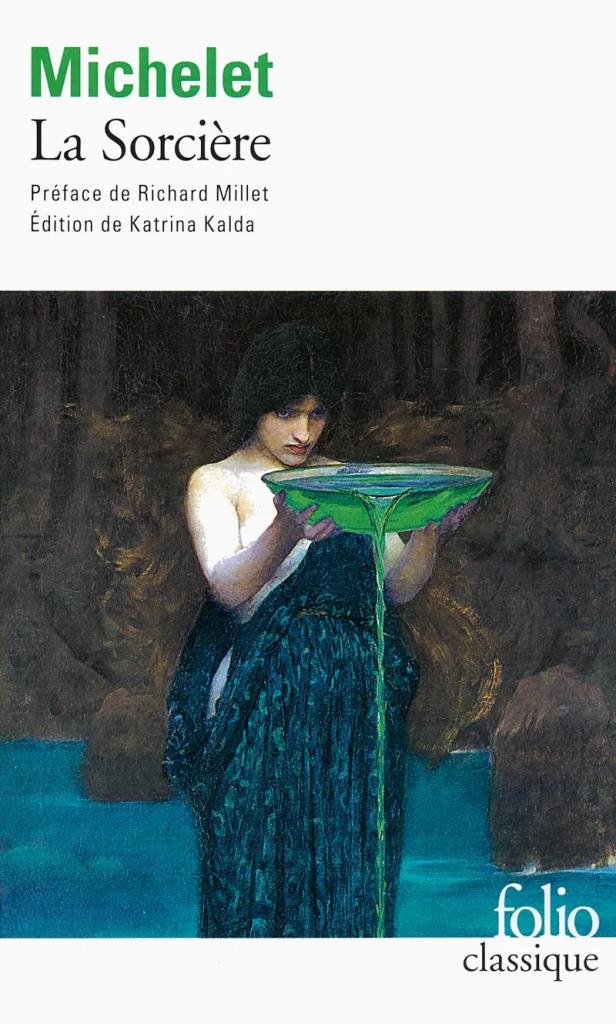 Le précurseur, Jules Michelet, qui a fait de la sorcière une femme, quoi d'autre ? Le précurseur, Jules Michelet, qui a fait de la sorcière une femme, quoi d'autre ?
Jules Michelet, La Sorcière Édition de Katina Kalda Collection Folio Classique (n° 6125) Gallimard
Dans cet essai – qui se lit comme un roman –, le grand historien de la Révolution désensorcelle la sorcière : il la réhabilite, en montrant qu'elle n'est que le résultat d'une époque. Dans la société féodale du Moyen Âge, elle est l’expression du désespoir du peuple. À travers la sorcière, c’est à la femme que Michelet s’intéresse : elle dont la servitude absolue la conduit à transgresser les règles établies par l'Église et le pouvoir. Il met en avant sa féminité, son humanité, son innocence : ce par quoi elle subvertit tout discours visant à la cerner. En l'arrachant aux terrifiants manuels d’Inquisition et aux insupportables comptes rendus de procès, en faisant sentir ce qu’il y a d'insaisissable dans la figure de la sorcière, il la rend à sa dimension poétique.
Du côté des Ardennes, une autrice belge
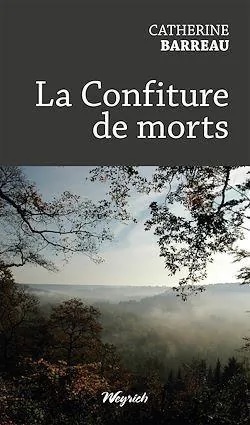 Catherine Barreau, La confiture de morts, Éd. Weyrich, 2021 Catherine Barreau, La confiture de morts, Éd. Weyrich, 2021
"Véra, une adolescente passionnée de lecture et résolument solitaire, vit à Namur avec son père, un avocat respecté, dans une maison au bas d’un coteau de la citadelle. Mais lorsque la mort de son père survient quelques jours avant sa majorité, elle préfère conserver le corps pour éviter d’être mise sous tutelle par une tante qu’elle ne souhaite pas revoir. Cela provoque son internement dans un hôpital psychiatrique, mais Véra est obsédée par une promesse faite à son père et décide, lors d’une sortie autorisée, de retourner au hameau des origines paternelles, Mortepire, où sa tante Claire et sa cousine Lucie vivent toujours. C’est là, dans les paysages envoûtants de la Gaume, que Véra découvrira les secrets des origines familiales." [Babelio]
Du côté d'un petit village du centre de la France,
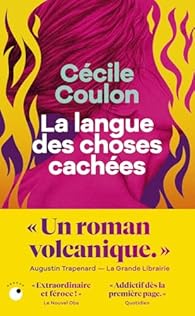 quand le fils brise la lignée des croyances quand le fils brise la lignée des croyances
Cécile Coulon, La langue des choses cachées, Ed. de l'Iconoclaste 2024, Proche 2025
"À la tombée du jour, un jeune guérisseur se rend dans un village reculé. Sa mère lui a toujours dit : " Ne laisse jamais de traces de ton passage. " Il obéit toujours à sa mère. Sauf cette nuit-là.
Cécile Coulon explore dans ce roman des thèmes universels : la force
poétique de la nature et la noirceur des hommes. Elle est l'autrice de Une bête au Paradis, Prix littéraire du Monde, Trois saisons d'orage, prix des Libraires, et du recueil de poèmes Les Ronces, prix Apollinaire.
Avec La Langue des choses cachées, ses talents de romancière et de poétesse se mêlent dans une oeuvre littéraire exceptionnelle." [Babelio]
***
D'un enterrement l'autre, avec drôlerie...
une femme qui se défait des emprises
sociales, bienséantes, conformistes, religieuses
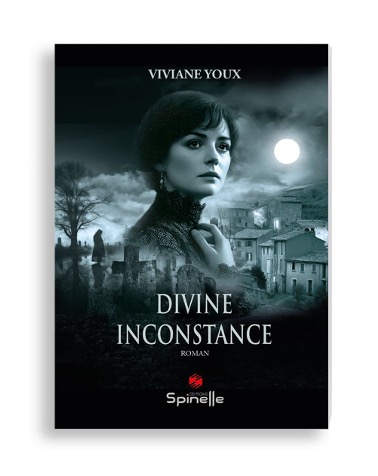 Viviane Youx, Divine inconstance, Éd. Spinelle 2025 Viviane Youx, Divine inconstance, Éd. Spinelle 2025
"Quelle énigme plane sur ce petit village ? Constance, mystérieuse, y emmène Paul à un enterrement, sans rien vouloir lui dire sur cette religion secrète qui, pourtant, la hante. Un rêve récurrent la tourmente, qu’elle oublie toujours. Installée depuis quelques années dans cette ville du centre de la France, elle se reconstruit une vie en apparence ordinaire, que quelques rencontres font vaciller : des jeunes qui font des recherches sur une croix, un collègue de Paul, Manu, qui l’incite à des révélations. Quelle vie a-t-elle menée avant d’arriver ici ? […] Il lui faudra des détours, nombreux, pour parler. [...] Une aventure sexuelle cocasse lui a fait découvrir une sensualité et un plaisir qu’elle avait étouffés jusque-là. Il lui faut, pour commencer à s’affranchir du poids religieux, les mensonges d’un homme brisé par une éducation traditionaliste et réduit à des expériences sexuelles loufoques. Est-elle prête à affronter la vérité sur elle-même ? Et quelles en seront les conséquences pour son entourage ?"
|
| |
|
|
|
|
|
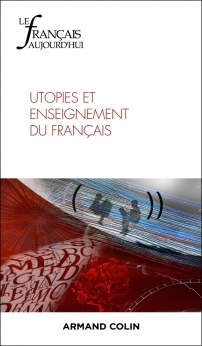 Utopies et enseignement du français, Le français aujourd'hui n° 229, Juin 2025 - coordonné par Emmanuelle Guérin et Anne-Claire Raimond. "Le dossier thématique du présent numéro du Français aujourd’hui interroge la question des utopies dans une vision humaniste de l’enseignement du français, en s’intéressant aux différentes modalités à travers lesquelles celle-ci peut s’exprimer dans les contextes de français langue première (FL1re) et de français langue étrangère (FLE). Le mot « utopie » est devenu un véritable « caméléon », selon Thomas Bouchet, prêt à être investi de significations très diverses, parfois jusqu’au contresens et au malentendu : « Il est accueillant, [...] se teinte de ce qui l’entoure. C’est une sorte de pâte à modeler, objet de discussions et même de polémiques toujours recommencées » […] Philippe Meirieu (…) souligne que les utopies pédagogiques ne font pas exception : elles oscillent entre des visions émancipatrices et des systèmes éducatifs rigides et contraignants. Il souligne que ces utopies, en imposant un ordre rigide, négligent l’éducabilité des individus et les assignent à des rôles prédéterminés. […] La postface, rédigée par Louis Ucciani, offre un point de vue philosophique sur l’utopie, à travers le regard de Charles Fourier, rêveur et praticien auquel on attribue aujourd’hui « non plus une vision de ce qui relève d’un simple exercice de la pensée, mais bien une action posée. » Le texte de L. Ucciani fait un pas de côté pour développer un propos invitant à questionner l’utopie. Il permet de mettre en résonance la position critique de Fourier face aux utopistes et les différentes problématiques traitées dans les articles de ce dossier. L’enseignement de la langue et des langues est traversé par le paradoxe inhérent à l’utopie et, à l’image de Fourier, les auteurs des articles pointent des lieux où il se manifeste." Utopies et enseignement du français, Le français aujourd'hui n° 229, Juin 2025 - coordonné par Emmanuelle Guérin et Anne-Claire Raimond. "Le dossier thématique du présent numéro du Français aujourd’hui interroge la question des utopies dans une vision humaniste de l’enseignement du français, en s’intéressant aux différentes modalités à travers lesquelles celle-ci peut s’exprimer dans les contextes de français langue première (FL1re) et de français langue étrangère (FLE). Le mot « utopie » est devenu un véritable « caméléon », selon Thomas Bouchet, prêt à être investi de significations très diverses, parfois jusqu’au contresens et au malentendu : « Il est accueillant, [...] se teinte de ce qui l’entoure. C’est une sorte de pâte à modeler, objet de discussions et même de polémiques toujours recommencées » […] Philippe Meirieu (…) souligne que les utopies pédagogiques ne font pas exception : elles oscillent entre des visions émancipatrices et des systèmes éducatifs rigides et contraignants. Il souligne que ces utopies, en imposant un ordre rigide, négligent l’éducabilité des individus et les assignent à des rôles prédéterminés. […] La postface, rédigée par Louis Ucciani, offre un point de vue philosophique sur l’utopie, à travers le regard de Charles Fourier, rêveur et praticien auquel on attribue aujourd’hui « non plus une vision de ce qui relève d’un simple exercice de la pensée, mais bien une action posée. » Le texte de L. Ucciani fait un pas de côté pour développer un propos invitant à questionner l’utopie. Il permet de mettre en résonance la position critique de Fourier face aux utopistes et les différentes problématiques traitées dans les articles de ce dossier. L’enseignement de la langue et des langues est traversé par le paradoxe inhérent à l’utopie et, à l’image de Fourier, les auteurs des articles pointent des lieux où il se manifeste."

Enseignement explicite et étude de la langue, Le français aujourd'hui n° 230, Septembre 2025 - coordonné par Florence Mauroux, Véronique Paolocci & Cécile Avezard-Roger
"L’enseignement explicite, une préoccupation d’actualité. Depuis le début des années 2000, on assiste à un débat animé sur l’efficacité des démarches d’enseignement et, plus particulièrement, sur la nécessité d’un enseignement explicite pour favoriser les apprentissages des élèves. Ce débat s’est illustré encore récemment outre-Atlantique dans les médias entre les défenseurs de deux visions distinctes de ce que peut être l’enseignement explicite. […] L’enseignement explicite soulève ainsi plusieurs questions : que rend-on explicite ? qui explicite ? pour qui, pourquoi, quand et comment ? Pour répondre à ces questions, deux approches pédagogiques assez différentes semblent émerger. On trouve, d’un côté, un modèle d’enseignement explicite, issu de travaux nord-américains (…), qui articule trois phases, guidées par l’enseignant : 1) une phase de modelage : l’enseignant fait une démonstration de la résolution d’un problème en rendant explicites les stratégies mobilisées ; 2) une phase de pratique guidée : l’élève réalise des tâches similaires et remobilise les stratégies utilisées lors du modelage ; 3) une phase de pratique autonome : l’élève réinvestit seul ce qu’il a compris lors des phases précédentes. D’un autre côté, des chercheurs français (…) proposent un modèle d’enseignement explicite permettant de se focaliser sur l’activité cognitive et pas seulement sur la tâche de l’élève. Pour y parvenir, ces chercheurs mettent notamment en avant la nécessité de consacrer du temps aux répétitions, aux verbalisations qui guident l’action, ainsi qu’à l’explication collective des conditions de réussite des tâches. Dans cette démarche, la place et le rôle des interactions, entre pairs et avec l’enseignant, sont déterminants."
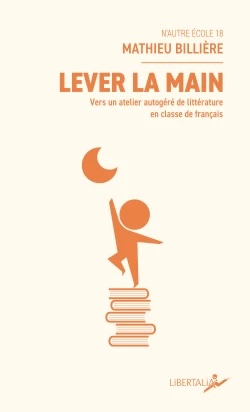 Lever la main, Mathieu Billière, éd. Libertalia, 2 septembre 2025 - 240 pages — 10 € Lever la main, Mathieu Billière, éd. Libertalia, 2 septembre 2025 - 240 pages — 10 €
"L’enseignement littéraire prend trop souvent la forme d’un exercice d’admiration dont on connaît les limites : recherche d’une entente tacite, création d’un entre-soi, démarche de sélection. Ceci alors que la littérature est présentée par celles et ceux qui en ont le goût comme l’outil de l’émancipation par excellence, de la découverte de soi et du sens qu’on apporte au monde. L’enseignant de lettres est à la croisée de ce paradoxe : comment, dans un cadre programmé par les épreuves finales, donner aux élèves cette expérience d’émancipation ?
En s’interrogeant, en essayant, en dialoguant avec lui-même, il voit une hypothèse se dessiner peu à peu : faire de la classe de français un atelier, où le travail collectif autorise les individus en montrant que le texte est accessible à tous·tes."
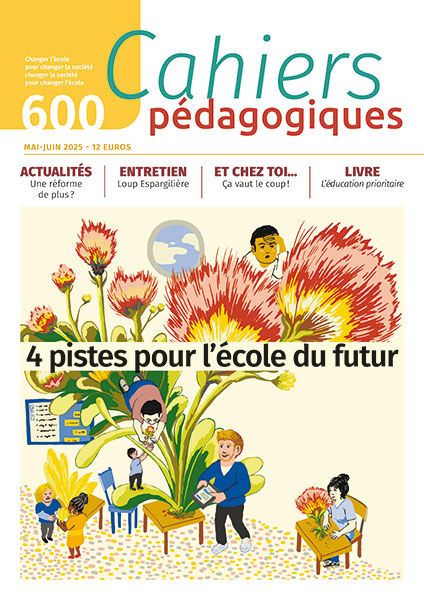 4 pistes pour l'école du futur, n° 600 des Cahiers pédagogiques, mai-juin 2025 - numéro coordonné par Nicole Priou, Laurent Reynaud et Jean-Michel Zakhartchouk. 4 pistes pour l'école du futur, n° 600 des Cahiers pédagogiques, mai-juin 2025 - numéro coordonné par Nicole Priou, Laurent Reynaud et Jean-Michel Zakhartchouk.
"À quoi ressemblera l’école qui vient ? Nous proposons dans ce dossier une esquisse de ce qu’elle pourrait ou devrait être à nos yeux. Quatre enjeux pour la penser : développer la coopération pour mieux apprendre, favoriser l’émancipation des futurs citoyens, relever le défi écologique et faire un usage précautionneux de l’intelligence artificielle. En croisant essais pédagogiques dans des classes d’aujourd’hui, éclairages de la recherche, et sans nier les difficultés du quotidien qui parfois nous épuisent, ce dossier contribue à l’écriture d’un scénario heureux et réaliste pour l’école de demain. Commander ce numéro"
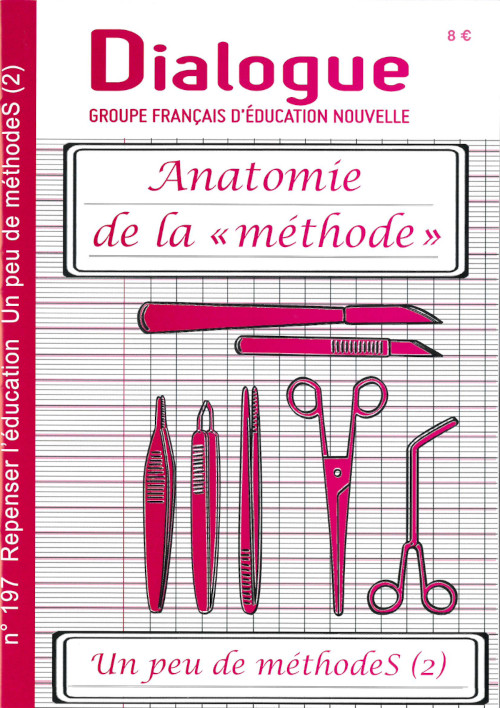
Anatomie de la "méthode" - Un peu de méthodeS (2), Dialogue n° 197, Revue du GFEN, juillet 2025
"Ce numéro 197 prolonge les réflexions commencées dans le numéro précédent sur les « méthodes » en se centrant, cette fois, sur une « méthode » particulière, celle qui caractérise le GFEN : la « démarche d’auto-socio-construction des savoirs ». Des articles décrivent les principes qui la fondent – conceptions des savoirs à enseigner et des sujets qui apprennent – et exposent les processus à mettre en œuvre pour qu’elle soit un outil pour les enseignants et les formateurs. D’autres contributions donnent des exemples de son application.
Mais le numéro ne se limite pas à « la démarche », il présente d’autres méthodes et outils utilisables par les enseignants."
Travailler la maitrise de la langue - Faire progresser les élèves dans toutes les 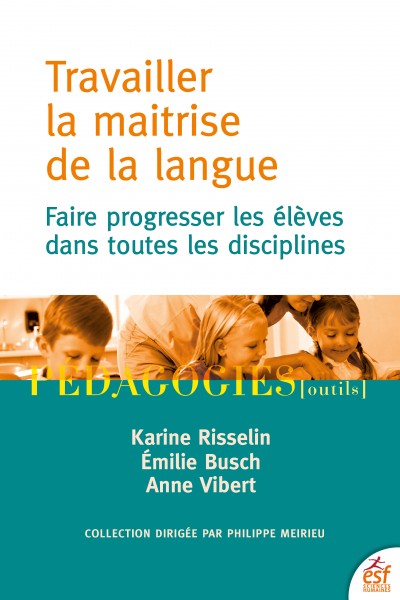 disciplines, Karine Risselin, Anne Vibert, Emilie Busch - Mai 2023, ESF. "Nul n’est besoin de souligner l’importance de la maitrise de la langue dans la réussite scolaire. Mais on sous-estime peut-être encore trop son apprentissage rigoureux dans l’ensemble des disciplines d’enseignement. Car la langue n’est pas le simple « vêtement » de connaissances qui lui préexisteraient ; elle est le matériau même grâce auquel on peut construire les savoirs. C’est en travaillant la langue qu’on apprend à penser, en des opérations intellectuelles qui ne se limitent pas à la compréhension et à l’usage de mots ou de phrases, mais impliquent des remaniements et des reconfigurations qui permettent d’entrer dans une authentique réflexion. Les élèves ne comprennent et ne conceptualisent que dans une prise de parole raisonnée ou le stylo à la main. C’est pourquoi l’ouvrage de Karine Risselin, Émilie Busch et Anne Vibert s’impose aussi bien pour les enseignants du premier que du second degré." Voir la présentation sur le site d'ESF. disciplines, Karine Risselin, Anne Vibert, Emilie Busch - Mai 2023, ESF. "Nul n’est besoin de souligner l’importance de la maitrise de la langue dans la réussite scolaire. Mais on sous-estime peut-être encore trop son apprentissage rigoureux dans l’ensemble des disciplines d’enseignement. Car la langue n’est pas le simple « vêtement » de connaissances qui lui préexisteraient ; elle est le matériau même grâce auquel on peut construire les savoirs. C’est en travaillant la langue qu’on apprend à penser, en des opérations intellectuelles qui ne se limitent pas à la compréhension et à l’usage de mots ou de phrases, mais impliquent des remaniements et des reconfigurations qui permettent d’entrer dans une authentique réflexion. Les élèves ne comprennent et ne conceptualisent que dans une prise de parole raisonnée ou le stylo à la main. C’est pourquoi l’ouvrage de Karine Risselin, Émilie Busch et Anne Vibert s’impose aussi bien pour les enseignants du premier que du second degré." Voir la présentation sur le site d'ESF.
|
| |
|
|
|

